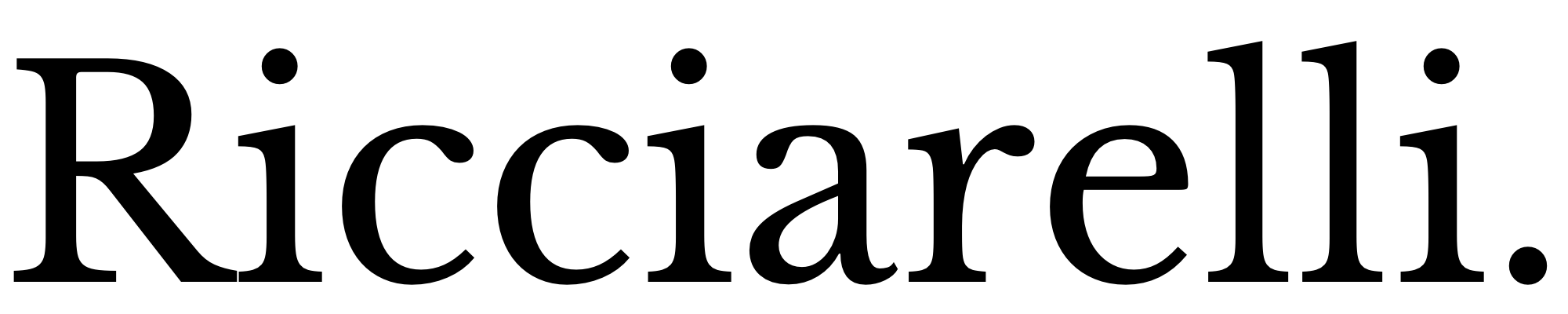Très souvent, je travaille le dimanche.
Pas pour développer une nouvelle idée brillante. Pas pour faire avancer un projet exaltant. Pas même pour préparer la semaine à venir avec enthousiasme. Je travaille le dimanche parce qu’il y a des choses en retard. Des choses que je n’ai pas eu le courage ou le temps d’affronter plus tôt. Des détails qu’il faut bien régler à un moment. Et ce moment, c’est souvent le dimanche.
Ce n’est pas glorieux. Ce n’est pas stratégique. Ce n’est même pas vraiment efficace. C’est juste… nécessaire. Ce sont les papiers qu’on n’a pas classés. Les factures qu’on n’a pas envoyées. Les mails laissés en suspens parce qu’ils nous coûtaient un effort qu’on ne pouvait pas fournir sur le moment. Ce sont les devis oubliés, les relances à faire, les petites choses administratives qui, mises bout à bout, forment une masse opaque qui finit par peser sur la respiration.
Le dimanche soir, je ne me sens pas puissant.
Je ne suis pas dans une dynamique de conquête.
Je suis dans une forme de décence. Celle de rattraper, de remettre un peu d’ordre, de tenir debout.
Il y a dans ces moments quelque chose de profondément silencieux.
Un bureau pas rangé. Une lumière trop blanche. Une tasse froide.
Pas de musique. Pas d’adrénaline. Mais une sorte de pacte intérieur que je tiens avec moi-même : avancer, même un peu, même mal, même lentement.
Ce n’est pas un moment que je montre. Ce n’est pas un moment que je partage. Et pourtant, je crois que beaucoup d’entrepreneurs connaissent ça. Ce dimanche qui ne repose pas, qui n’éclaire pas, mais qui permet juste d’éviter l’effondrement de la pile. Un entre-deux. Une zone grise. Une petite réparation invisible.
C’est sans doute dans ces recoins que se construisent les projets solides.
Pas dans les grandes annonces. Pas dans les relances euphorisantes.
Mais dans cette fidélité au détail, dans cette capacité à faire ce qui doit être fait même quand on en a marre.
Et dans cette discrète endurance que personne ne voit, mais qui finit toujours par compter.